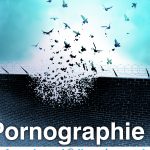La thèse de Denis Kennel est publiée !
Denis Kennel, directeur du département francophone du Centre de Formation du Bienenberg et pasteur à l’Eglise mennonite de la Ruche à St-Louis (68), a travaillé ces dernières années sur une thèse de doctorat, soutenue à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine le 18 novembre 2015.
Cette thèse a été publiée sous la forme d’un livre en février 2017, sous le titre « De l’esprit au salut – Une anthropologie anabaptiste », aux Editions du Cerf. On y trouve une comparaison des écrits de deux anabaptistes du 16e siècle, Balthasar Hubmaier et Pilgram Marpeck.
La comparaison porte sur la la manière dont la grâce de Dieu renouvelle la volonté de l’être humain pour répondre au salut. Cela implique d’une part que cette volonté de l’être humain n’est pas entièrement déchue, mais qu’elle est plutôt emprisonnée par les effets de la Chute et d’autre part qu’en l’être humain se trouve un « ingrédient » placé par Dieu et permettant à l’être humain de répondre à la restauration apportée par Jésus-Christ, pour une vie de disciple et la participation volontaire à l’Eglise de Jésus-Christ.
Par cette manière d’articuler la réponse de l’être humain à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ces anabaptistes se différencient de Martin Luther, sans pour autant quitter la mouvance de la Réforme. Comme le dit Neal Blough dans la préface (p. 13), l’anabaptisme « représente […] une « protestantisation » d’un courant de la théologie médiévale différent de celui suivi par Luther ».
On se réjouira de la publication de cette thèse, qui présente les résultats d’une recherche dans un domaine peu ou pas exploré en langue française, à savoir l’anthropologie des anabaptistes. Le sous-titre du livre fait écho à un ouvrage précédent de Neal Blough, « Christologie anabaptiste » (1984). L’ouvrage de Denis Kennel contribue donc fort utilement à une meilleure connaissance des contours de la position représentée par les anabaptistes du 16e siècle.
Résumé
Ce livre étudie l’anthropologie et la sotériologie de deux importants représentants du mouvement anabaptiste du XVIe siècle, Balthasar Hubmaier (1480/85-1528) et Pilgram Marpek (1495[?]-1556). Il vise à mettre en évidence la façon dont les deux théologiens ont articulé, dans les débats et polémiques de leurs époques, des vues souvent jugées contradictoires : d’une part, les grandes affirmations de « la Réforme » quant à la grâce et au salut ; d’autre part, la reconnaissance d’un certain libre arbitre de l’homme.
Les positions, d’abord examinées dans leur cohérence propre, sont ensuite situées par rapport à leurs sources immédiates puis mises en perspective. Leurs fondements doctrinaux communs sont énoncés : l’affirmation toujours maintenue du péché originel, mais une relativisation de ses effets ; la grâce conçue comme part aussi de la nature humaine, sollicitant et rendant possible la réponse de l’homme ; l’historicité du salut, enfin, et la centralité de l’événement Jésus-Christ.
Au terme de ce parcours, la thèse soutenue est que Hubmaier et Marpeck ont maintenu, dans le climat de culpabilisation qu’a connu l’Occident au XVIe siècle, une anthropologie plus « optimiste » que celle des réformateurs dits « magistériaux ». Ils attestent ainsi de l’existence, au sein de l’éventail des théologies issues de la Réforme, de formulations originales du rapport entre grâce et responsabilité humaine. Celles-ci, propose l’auteur, sont aussi légitimes et gagneraient à être davantage connues.
Références
Denis Kennel, De l’esprit au salut – Une anthropologie anabaptiste, Cerf, Paris, 2017, 334 pages